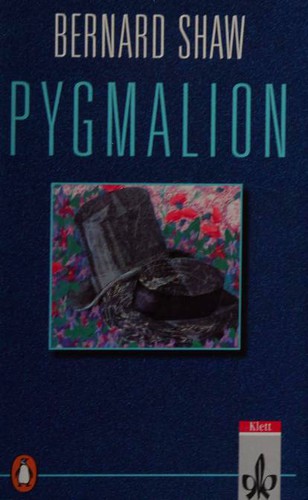Leito a publié une critique de Pygmalion par George Bernard Shaw
Pygmalion
4 étoiles
Dès le prologue, Bernard Shaw lance un clash en accusant les anglais de ne pas savoir parler leur propre langue, de ne pas savoir la prononcer ni l'épeler. Il désespère qu'on n'accorde pas l'attention qui leur est due aux linguistes et chercheurs en phonétique, qui seraient des sciences majeures. C'est assez drôle et délectable à lire, même si je pense que ça n'a pas été écrit dans un but humoristique mais bien au premier degré. Il explique s'être inspiré, pour cette œuvre, d'un personnage réel, expert absolu d'une science fort sous-estimée, et on commence déjà à se douter que la pièce qu'on s'apprête à lire sera une démonstration didactique des bienfaits de la phonétique. Mais d'un côté c'est revendiqué par l'auteur comme une vertu : l'art devrait être didactique selon lui. D'autre part, Pygmalion est beaucoup plus que ça. La pièce est assez vive et drôle, les dialogues et personnages …
Dès le prologue, Bernard Shaw lance un clash en accusant les anglais de ne pas savoir parler leur propre langue, de ne pas savoir la prononcer ni l'épeler. Il désespère qu'on n'accorde pas l'attention qui leur est due aux linguistes et chercheurs en phonétique, qui seraient des sciences majeures. C'est assez drôle et délectable à lire, même si je pense que ça n'a pas été écrit dans un but humoristique mais bien au premier degré. Il explique s'être inspiré, pour cette œuvre, d'un personnage réel, expert absolu d'une science fort sous-estimée, et on commence déjà à se douter que la pièce qu'on s'apprête à lire sera une démonstration didactique des bienfaits de la phonétique. Mais d'un côté c'est revendiqué par l'auteur comme une vertu : l'art devrait être didactique selon lui. D'autre part, Pygmalion est beaucoup plus que ça. La pièce est assez vive et drôle, les dialogues et personnages m'ont un peu évoqué du Billy Wilder dans leur raillerie et les jeux sur la langue et les sous-entendus (en tout cas c'est le ton que je donnais au texte à la lecture). Le professeur Higgins, personnage principal, est misogyne et condescendant, ce qui lui est reproché, mais aussi un peu pardonné sous le fait du "génie" et d'un carcatère "original", ce qui sont toujours des excuses bancales. Il en va de même pour la pièce où, il est difficile de savoir si l'auteur condamne davantage le pari douteux des acolytes phonétologues (faire passer une jeune fille des faubourg de Londres pour une duchesse en lui apprenant les manières et surtout la diction/prononciation et la langue d'une aristocrate) ou la candeur de la jeune fille qui croit qu'en ayant fait illusion elle peut en être (alors qu'elle devient la preuve vivante qu'il y a davantage que la langue qui sépare les classes), et qui finit par amèrement regretter d'être devenue un objet dans les mains de ses mécènes avec un horizon inatteignable, plutôt que d'avoir simplement continué sa vie de vendeuse de fleurs qui ne connaît rien d'autre. Le fait est que, quelque soit son réel point de vue (qui sans doute n'est pas totalement tranché), l'auteur parle de toutes ces intrications de langue, savoir et conscience propre qui font qu'une classe se distingue d'une autre, du Bourdieu avant l'heure. C'est un texte très intelligent et surprenant. J'en prends pour témoin le dernier acte, qui est une longue justification en prose (inadaptable ou presque) sur les raisons d'une absence de happy ending en histoire d'amour comme on aurait pu s'y attendre. C'est même quasiment un essai dans la pièce qui expose — après avoir quasiment traité ses lecteurs/critiques/spectateurs de fainéants en manque d'imagination — ses vues sur les mœurs de la société victorienne en exposant la suite "logique" de l'histoire.
Le lire en anglais est un plus, tant la question de la langue est importante, et je ne sais pas ce que valent les traductions disponibles.