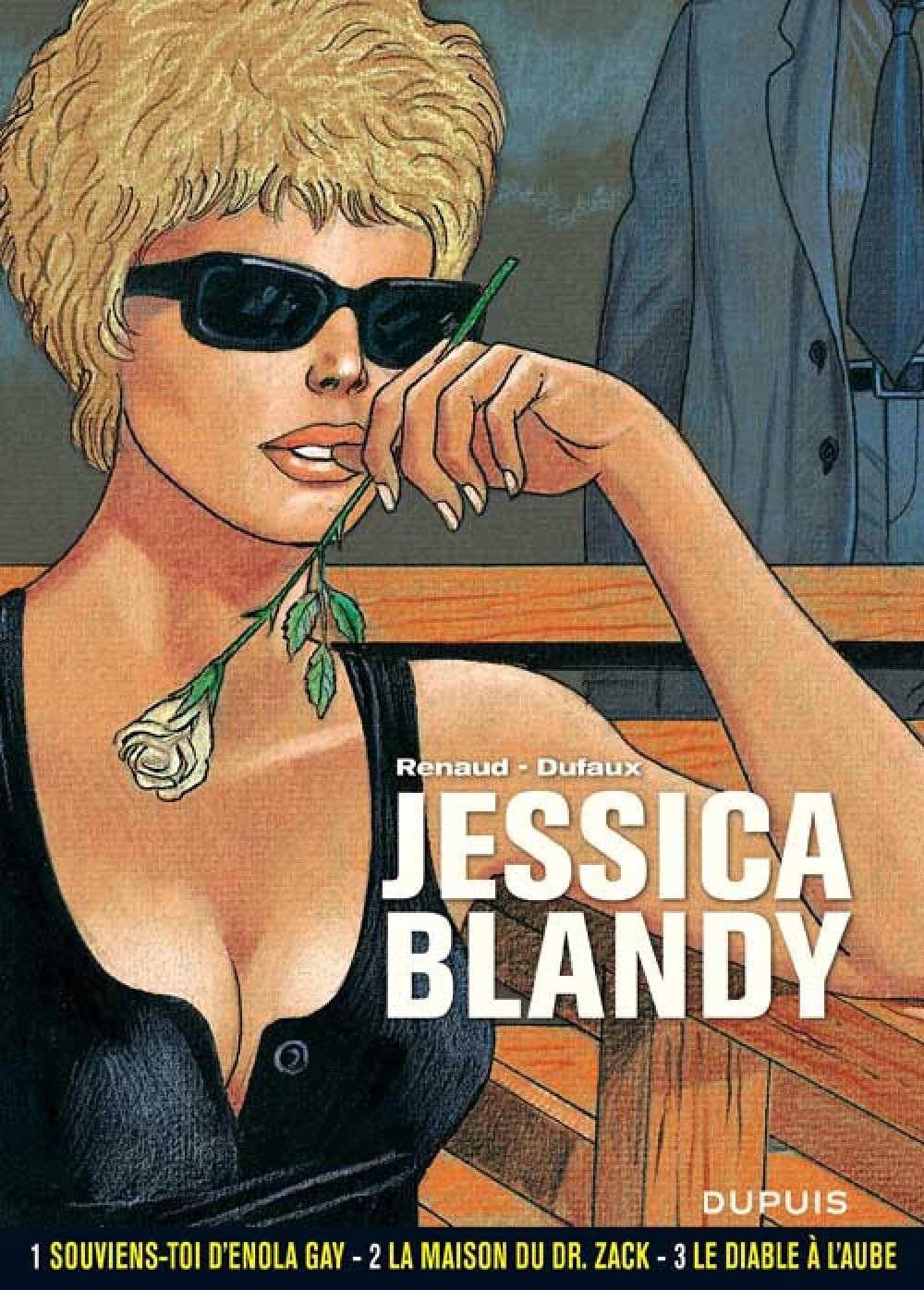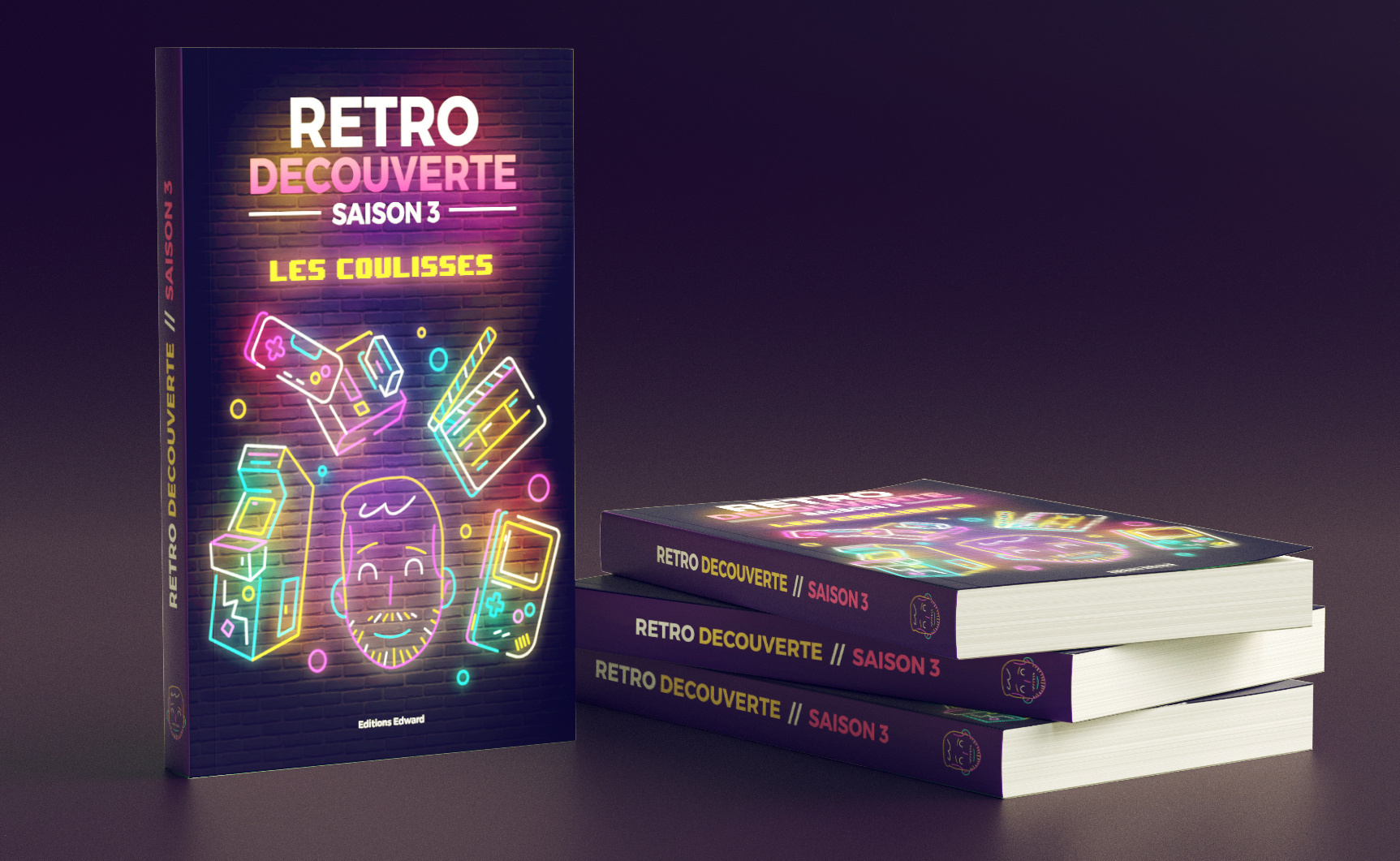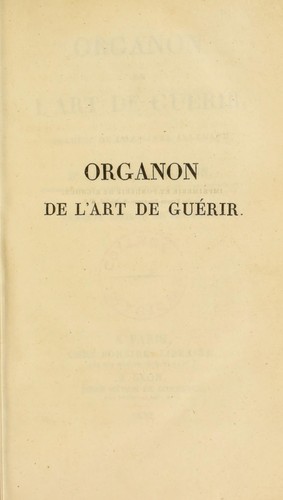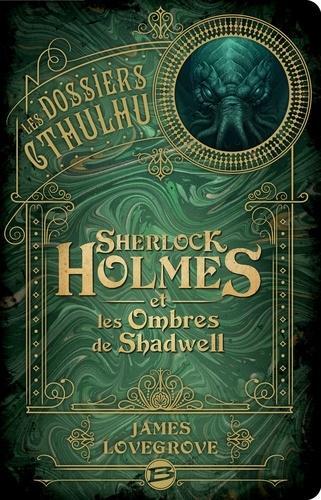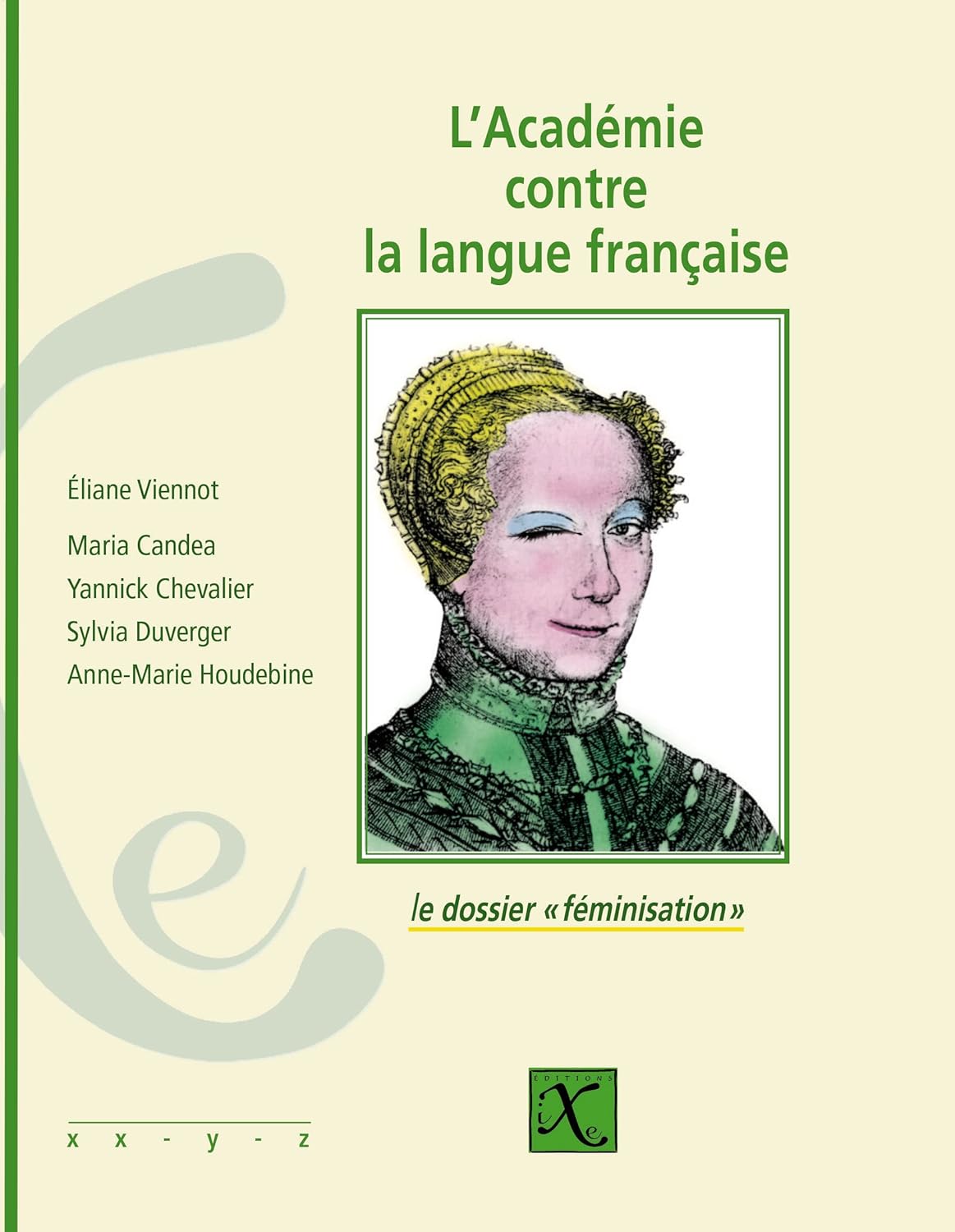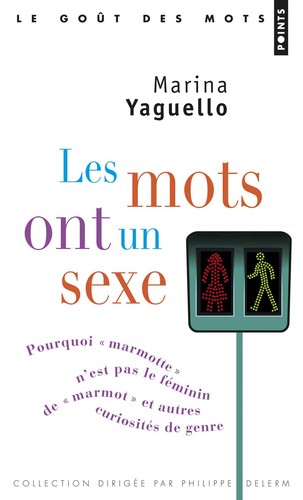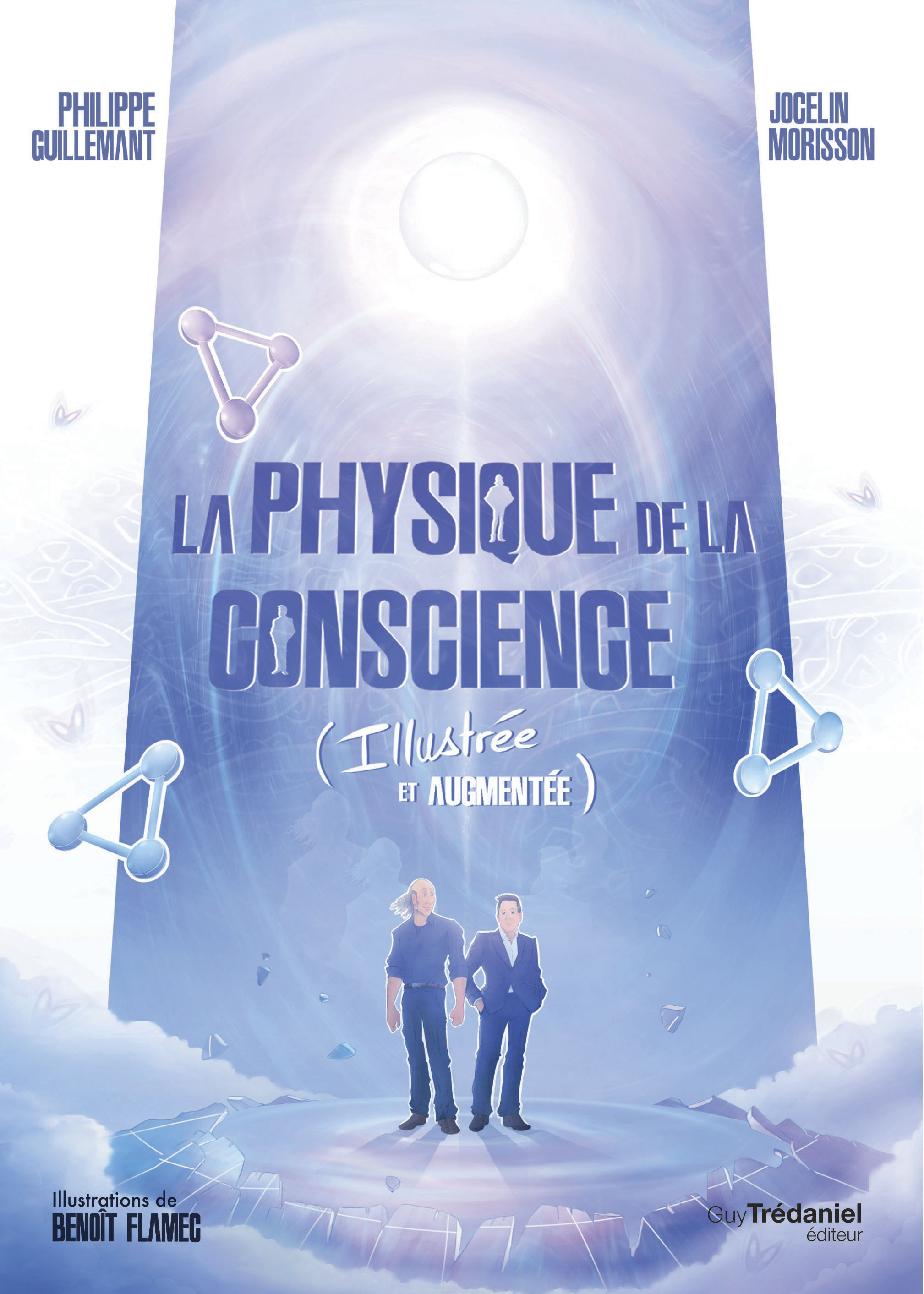« Tu es vraiment trop con », dit le père à sa fille de cinq ans. « Mais non, papa, pas con, conne ! » répond Anne-Natacha, pas vexée pour un sou, mais choquée de ce qu’elle considère comme une insulte à la langue. Ce n’est vraiment pas la peine d’être une fille si c’est pour être injuriée au masculin. C’est que la distinction entre le masculin et le féminin est au fondement même de la langue française. L’enfant s’en saisit de façon très précoce. Cette distinction structure pour lui l’apprentissage du lexique, à tel point qu’il l’étendrait volontiers aux verbes. S’il réagit aux écarts, l’enfant reste perplexe devant les dissymétries : « Et une fille marin, comment ça s’appelle ? Une marine ? » Et les appellations génériques des animaux lui apparaissent facilement complémentaires : « Et le rat, c’est le mari de la souris ? »
« De la logique avant toute chose ! » nous intime ainsi le locuteur du français en herbe.
Logique ? Quelle logique ? La langue ne connaît que sa logique propre. Les irrégularités, les dissymétries, les anomalies y foisonnent, sans mettre en cause pour autant son caractère systématique. En français, comme dans les autres langues romanes, le genre se présente non comme un reflet grammatical de l’organisation naturelle de l’univers, mais comme un système de classement de tous les substantifs, qu’ils représentent des êtres animés ou des choses. Il en découle que la distinction masculin/féminin assume dans la langue deux rôles tout à fait différents. S’agissant des êtres animés, le genre apparaît fondé en nature. Son rôle est sémantique. Il nous renvoie directement à la partition sexuelle. Dans le cas des êtres inanimés, la répartition apparaît au contraire tout à fait arbitraire ; elle est génératrice de contraintes purement grammaticales et donc, par essence, « illogique ».
- [Genre et sexe]