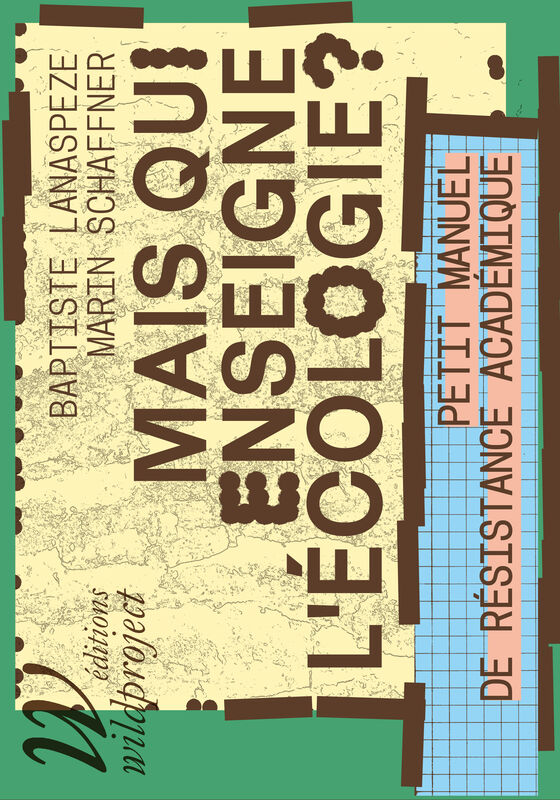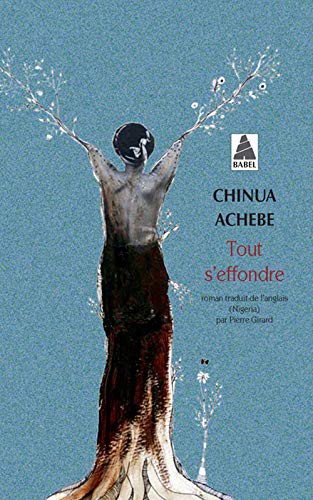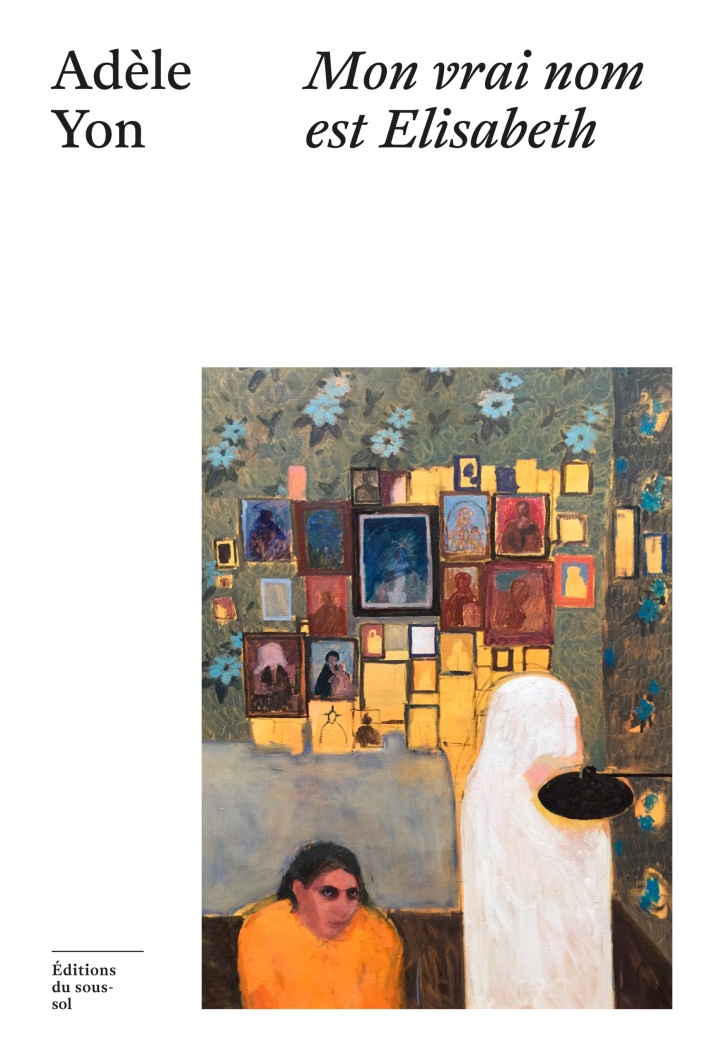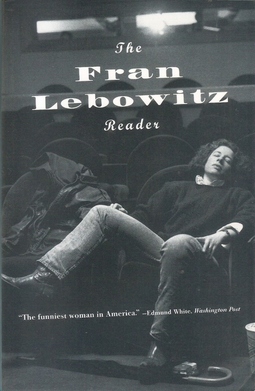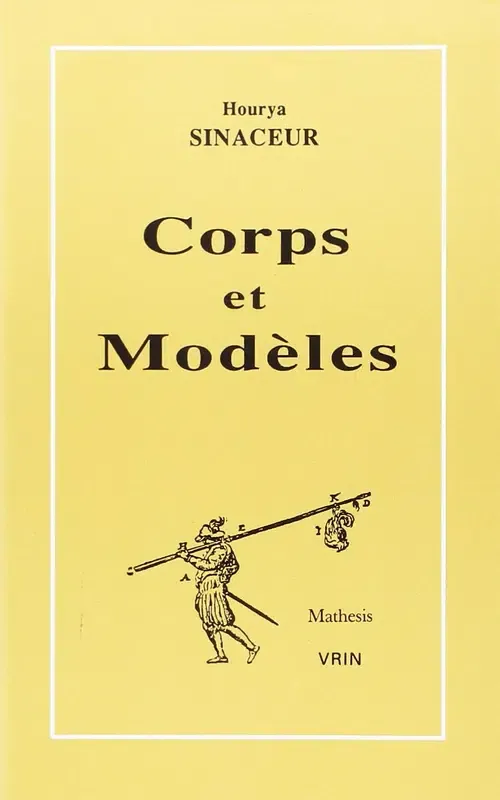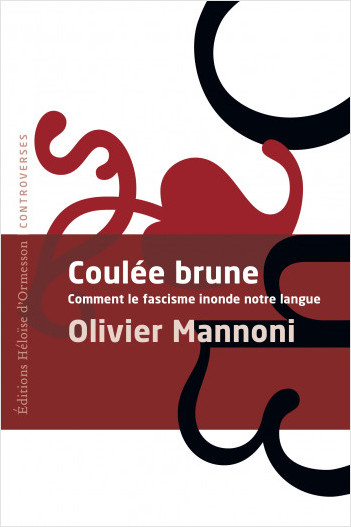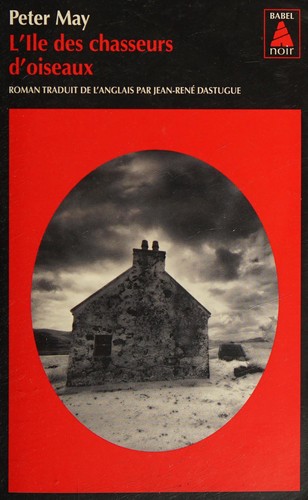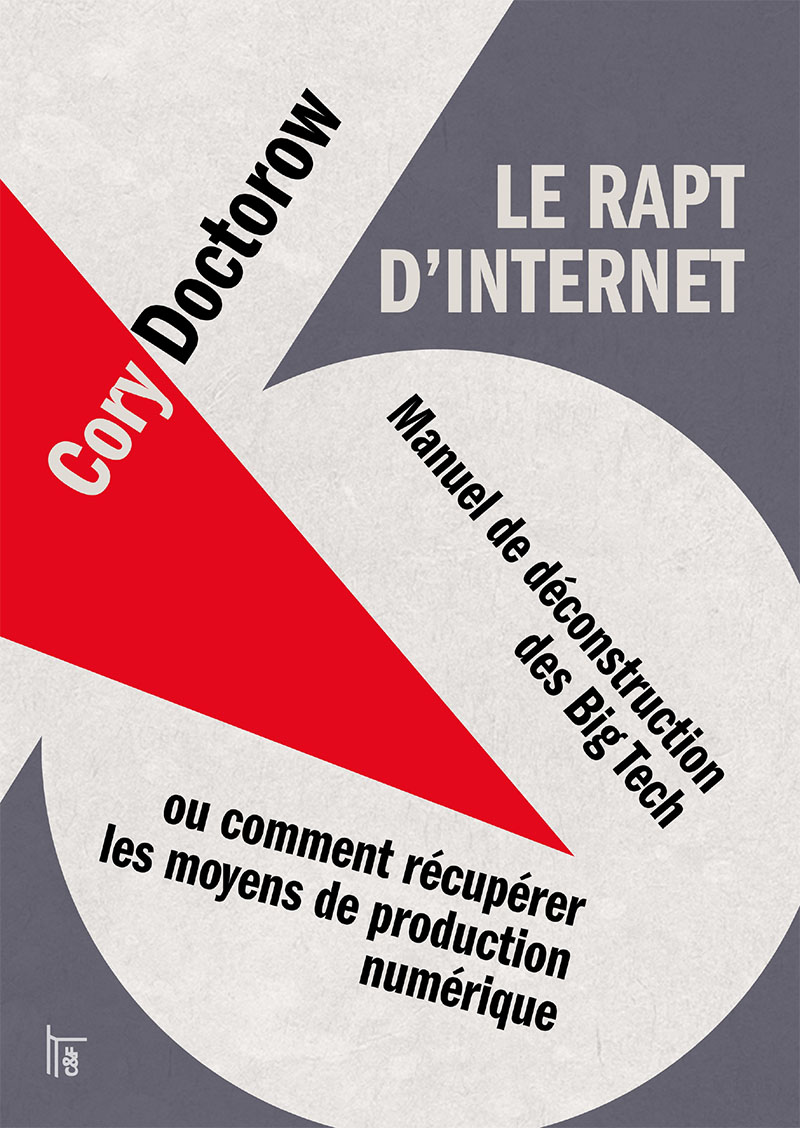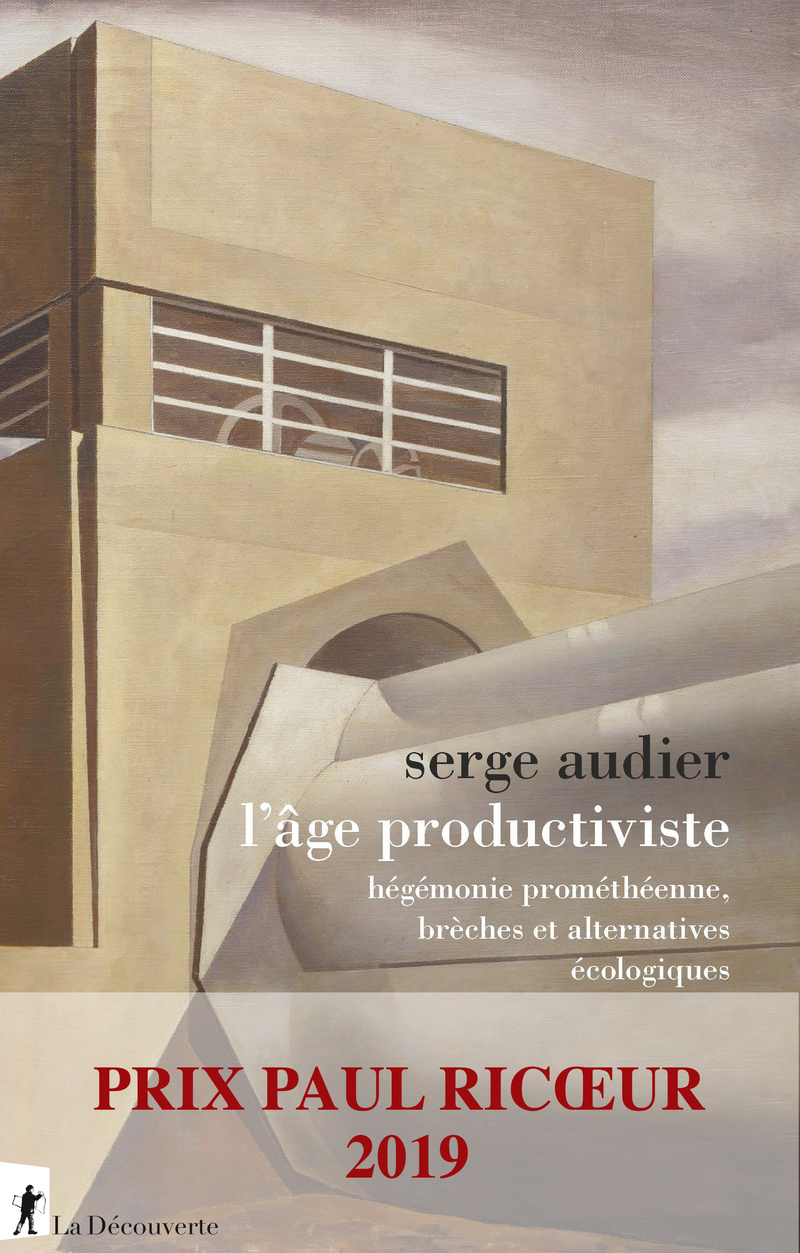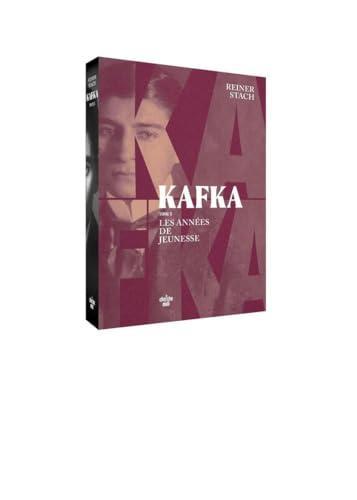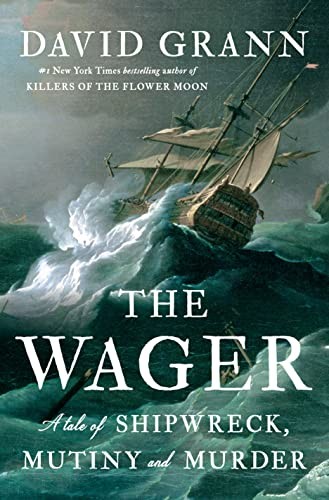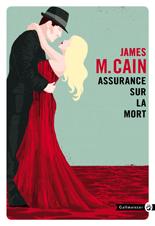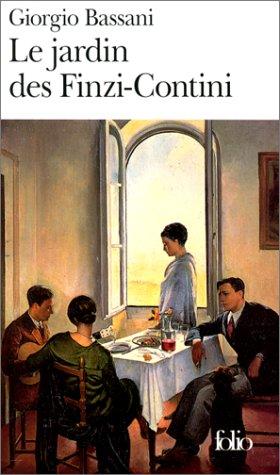Une immense trilogie. À la fin du 3e tome, Kafka s'apprête à entamer sa carrière publique d'écrivain, et on voudrait presque relire les deux premiers tomes. C'est intéressant aussi de constater que l'homme Kafka n'est pas (ou pas que) l'être coincé, écrasé, que suggèrent Gregor Samsa ou Joseph K., il avait manifestement beaucoup d'esprit et était un sportif accompli. La fin de ce 3e tome, il est vrai, explore largement une partie de la vie adulte de Kafka où il était relativement autonome, ses fréquentations, ses vacances, alors qu'au début du tome 1, on constate qu'il habitait chez ses parents, et que le poids de la famille lui était insupportable. J'aimerais savoir si l'auteur percevait déjà cette ambivalence quand il a entamé le chantier de cette fabuleuse biographie.
Profil
Apprenti mathématicien, professeur à l'université Paris Cité Apprenti musicien (batterie, tablas) Apprenti lecteur (romans, essais, poésie… en français ou en anglais)
Mastodon : antoinechambertloir@mathstodon.xyz
Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre
Livres de Antoine Chambert-Loir
Activité du compte
Flux RSS Retour
Antoine Chambert-Loir a terminé la lecture de Kafka (Les années de jeunesse) par Reiner Stach (Kafka, #3)
Antoine Chambert-Loir a cité Kafka (Les années de jeunesse) par Reiner Stach (Kafka, #3)
« Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, alors pourquoi lisons-nous ce livre ? Pour qu'il nous rende heureux comme tu le dis ? Mon Dieu, mais nous serions heureux aussi si nous n'avions pas de livres, et les livres qui nous rendent heureux, nous pourrions à la rigueur les écrire nous-mêmes. Nous avons besoin des livres qui agissent sur nous comme un malheur qui nous fait très mal, comme la mort de quelqu'un que nous aimions plus que nous-mêmes, comme si on nous bannissait dans les bois à l'écart de tous les hommes, comme un suicide, un livre doit être la hache pour la mer gelée en nous. »
— Kafka (Les années de jeunesse) de Reiner Stach (Kafka, #3) (Page 430)
Antoine Chambert-Loir a commencé la lecture de Kafka (Les années de jeunesse) par Reiner Stach (Kafka, #3)
Troisième tome de cette biographie monumentale de Franz Kafka. Les deux premiers tomes avaient abordé l, chronologiquement, les débuts de Kafka comme écrivain (Tome 1. Le temps des décisions) puis la maturité de l'écrivain, jusqu'à sa mort (Tome 2. Le temps de la connaissance). Pour ce troisième tome, Rainer Stach profite de la connaissance du personnage adulte et de l'écrivain qu'il nous a transmise pour analyser Les années de jeunesse*.
Pour le moment, après quelque 150 pages, le livre est plus ardu, moins biographique et plus « analytique » que les deux précédents, mais cela reste captivant !
Antoine Chambert-Loir a publié une critique de Les petites vertus par Natalia Ginzburg
Entre poésie, autobiographie et morale
5 étoiles
La vingtaine de petits textes qui composent ce recueil ont été écrits entre 1940 et 1960. Ils traversent donc des moments très différents de la vie de Natalia Ginzburg, mais rayonnent d'une commune poésie. Tous relèvent plus ou moins de l'autobiographie, pour laquelle l'autrice révèle une pudeur touchante mêlée d'une sensibilité déterminée. Si le dernier texte, qui sonne son titre au recueil, a un côté moraliste évident, elle reste subtile, car toute cette morale n'ignore jamais les erreurs et les imperfections ; mieux, elle s'en nourrit, et nourrit le désir d'une vie bonne. C'est une découverte miraculeuse qui m'a été offerte en prenant ce livre, presque au hasard, sur un étal de librairie au début du mis de juillet.
Antoine Chambert-Loir a commenté Les petites vertus par Natalia Ginzburg
C'est dommage de travailler tant et de lire si peu alors qu'il y a de si belles pages dans ce livre. Mais en corollaire, la lecture est lente, et chacun de ces petits textes a une chance de ne pas être immédiatement éclipsé par le suivant. Dans ce monde où nous sommes tentés de racheter des objets inutiles avant même qu'ils soient fichus ou obsolètes, Les chaussures trouées est touchant de justesse et de douceur. Lui et moi est un bel hommage à la vie de couple qu'elle menait avec, je suppose, son second mari, Gabriele Baldini. Tout n'est pas parfait, les déséquilibres sont patents, les colères brusques et au milieu de ça on devine un peu de bonheur.
Antoine Chambert-Loir a commenté Les petites vertus par Natalia Ginzburg
Antoine Chambert-Loir a commencé la lecture de Les petites vertus par Natalia Ginzburg
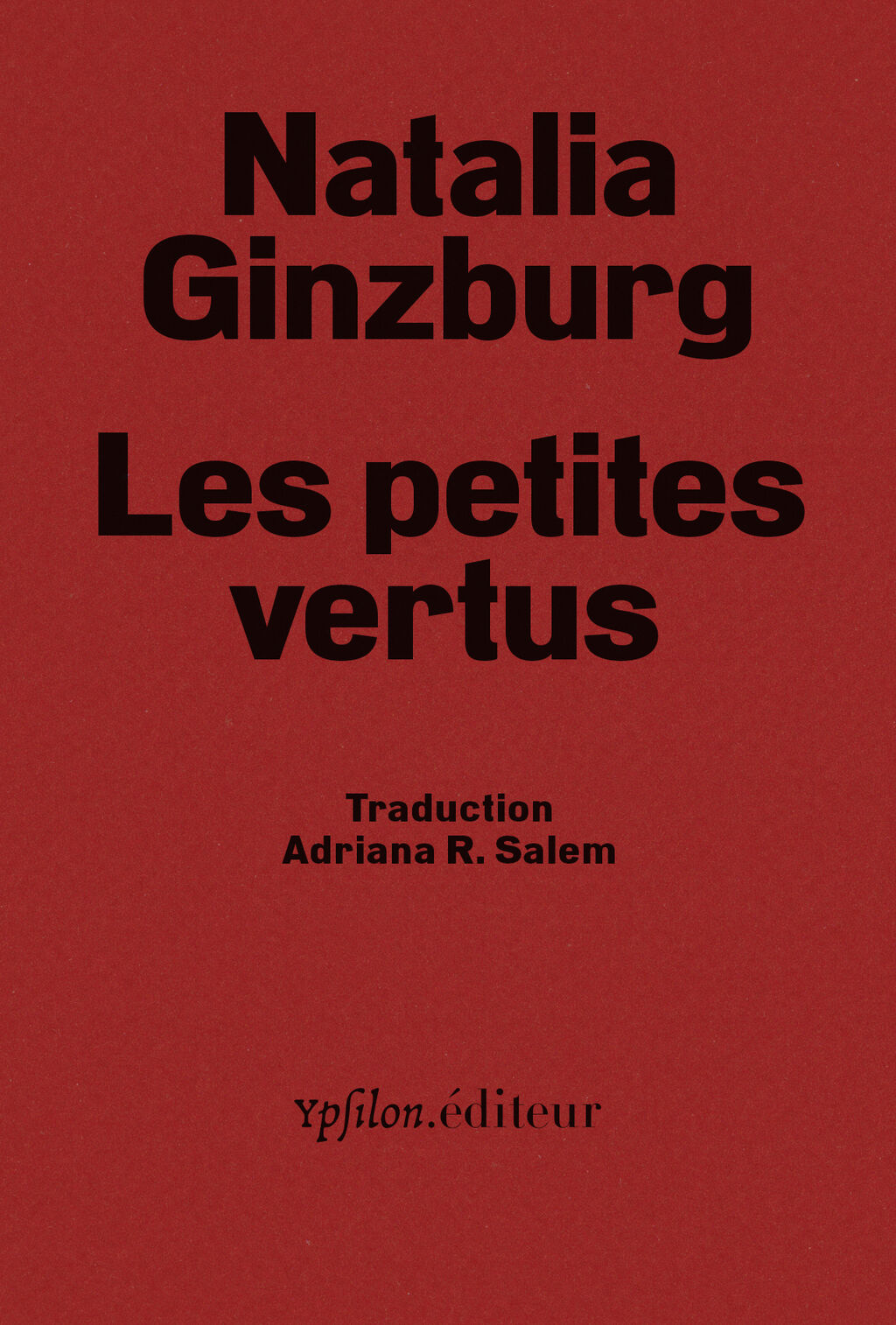
Les petites vertus de Natalia Ginzburg
Ces onze textes entre autobiographie et essai nous font (re) découvrir l’une des écritures les plus fortes du XXe siècle …
Antoine Chambert-Loir a commencé la lecture de Des phrases ailées par Virginia Woolf
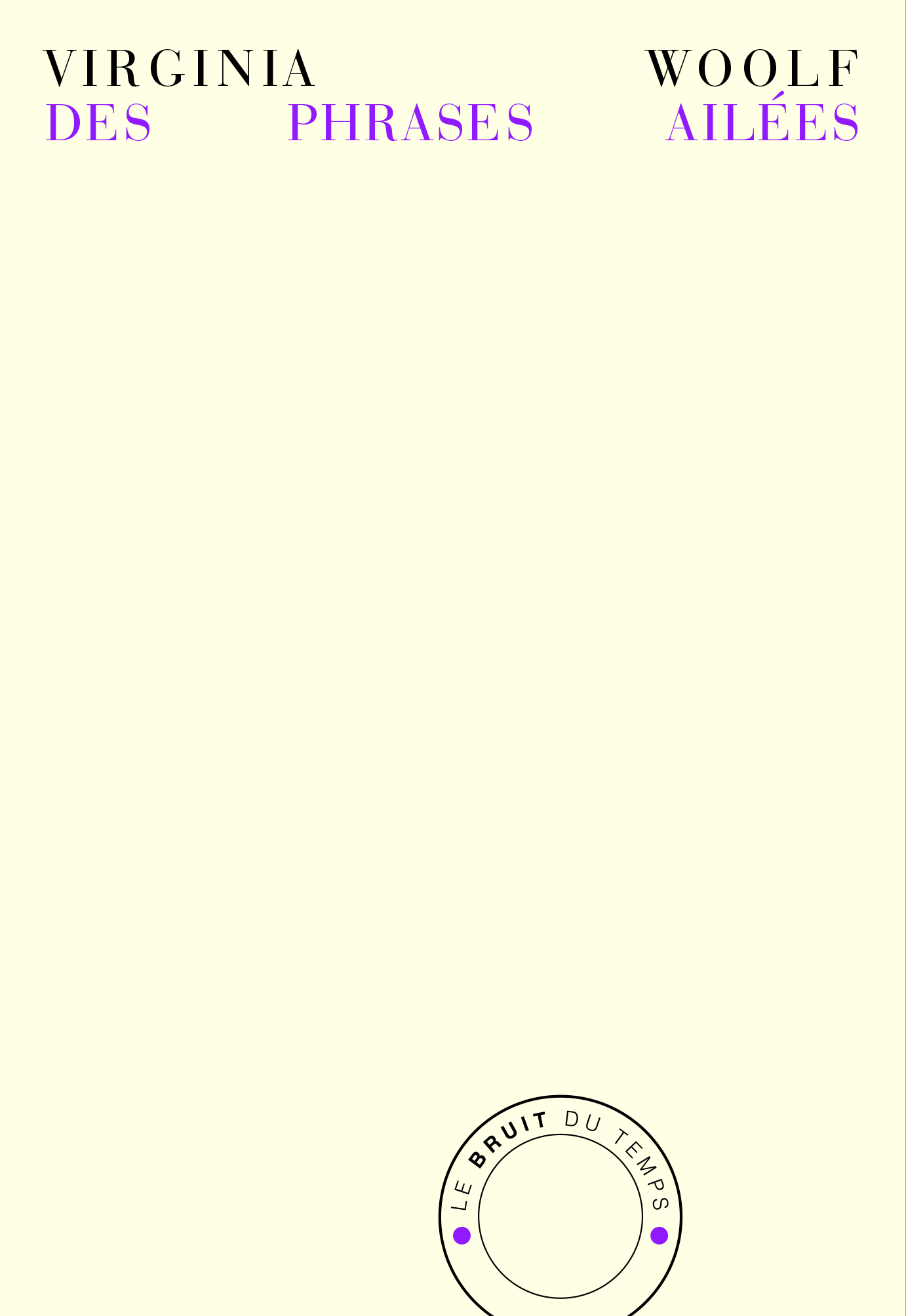
Des phrases ailées de Virginia Woolf
De 1904 à 1941, 29 essais de Virginia Woolf choisis, présentés et traduits par Cécile Wajsbrot. «L'oeil pouvait se baigner, …
Antoine Chambert-Loir a terminé la lecture de The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder par David Grann
C'était un livre fabuleux. Plus qu'une simple (mais grandiose) histoire maritime, on y trouve aussi une réflexion sur ces conquêtes impérialistes, le racisme qui les sous-tendait, et la façon dont les États écrivent leur propre Histoire.
Antoine Chambert-Loir a commencé la lecture de The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder par David Grann
L'histoire du Wager est vraie, et David Grann la raconte comme un roman. Peut-être par snobisme, je l'ai achetée en VO ; ça en ralentit la lecture, ce n'est peut-être pas plus mal puisque c'est une lecture de vacances. Et qu'on a le temps, hein?
Antoine Chambert-Loir a terminé la lecture de Assurance sur la mort par James M. Cain
Un très bon roman noir sans trop de morale et plein d'ironie. Énième variation sur la femme fatale, à moins que ce ne soit l'un des textes fondateurs du genre. Billy Wilder en a tiré un film en 1944 qu'il me tarde maintenant de voir.
Antoine Chambert-Loir a publié une critique de Le jardin des Finzi-Contini par Giorgio Bassani
Une tragédie moderne
5 étoiles
Si la 4e de couverture met en scène l'apparition de Micòl au narrateur, une scène lumineuse, tout le livre converge vers sa disparition, son refus de cette liaison amoureuse, et sa déportation et sa mort. Mais ça on le savait au tour début du livre, comme dans une tragédie grecque. Restait à apprendre comment, et laisser son cœur s'emplir peu à peu de nostalgie et de tristesse. Un livre magnifique où les émotions humaines ne dissimulent jamais leur ambiguïté.
Antoine Chambert-Loir a commenté Le jardin des Finzi-Contini par Giorgio Bassani
J'ai vu le film en ayant à peine commencé le livre. De fait, le film ignore la première partie du livre, et également son prologue. Mais surtout, il efface toute l'ambiguïté des relations entre ce groupe de jeunes, en particulier certain sous texte homosexuel qui me semble pourtant évident lorsque le narrateur découvre le studio d'Alberto Finzi-Contini. Et qu'Helmut Berger aurait sans difficulté pu rendre...
« Combien d'années s'est-il écoulé depuis ce lointain après-midi de juin ? Plus de trente. Pourtant, si je ferme les yeux, Micòl Finzi-Contini est toujours là, accoudée au mur d'enceinte de son jardin, me regardant et me parlant. En 1929, elle n'était guère plus qu'une enfant, une fillette de treize ans maigre et blonde avec de grands yeux clairs, magnétiques. Et moi, j'étais un jeune garçon en culotte courte, très bourgeois et très vaniteux, qu'un petit ennui scolaire suffisait à jeter dans le désespoir le plus puéril. Nous nous regardions fixement l'un l'autre. Au-dessus d'elle, le ciel était bleu et compact, un ciel chaud et déjà estival, sans le moindre nuage. Rien ne pourrait le changer, ce ciel, et rien, effectivement, ne l'a changé, du moins dans le souvenir. »
— Le jardin des Finzi-Contini de Giorgio Bassani (Page 76)
Ce beau passage qui marque l'arrivée de Micol dans le roman est repris en 4e de couverture. « Ce fut comme une apparition… »