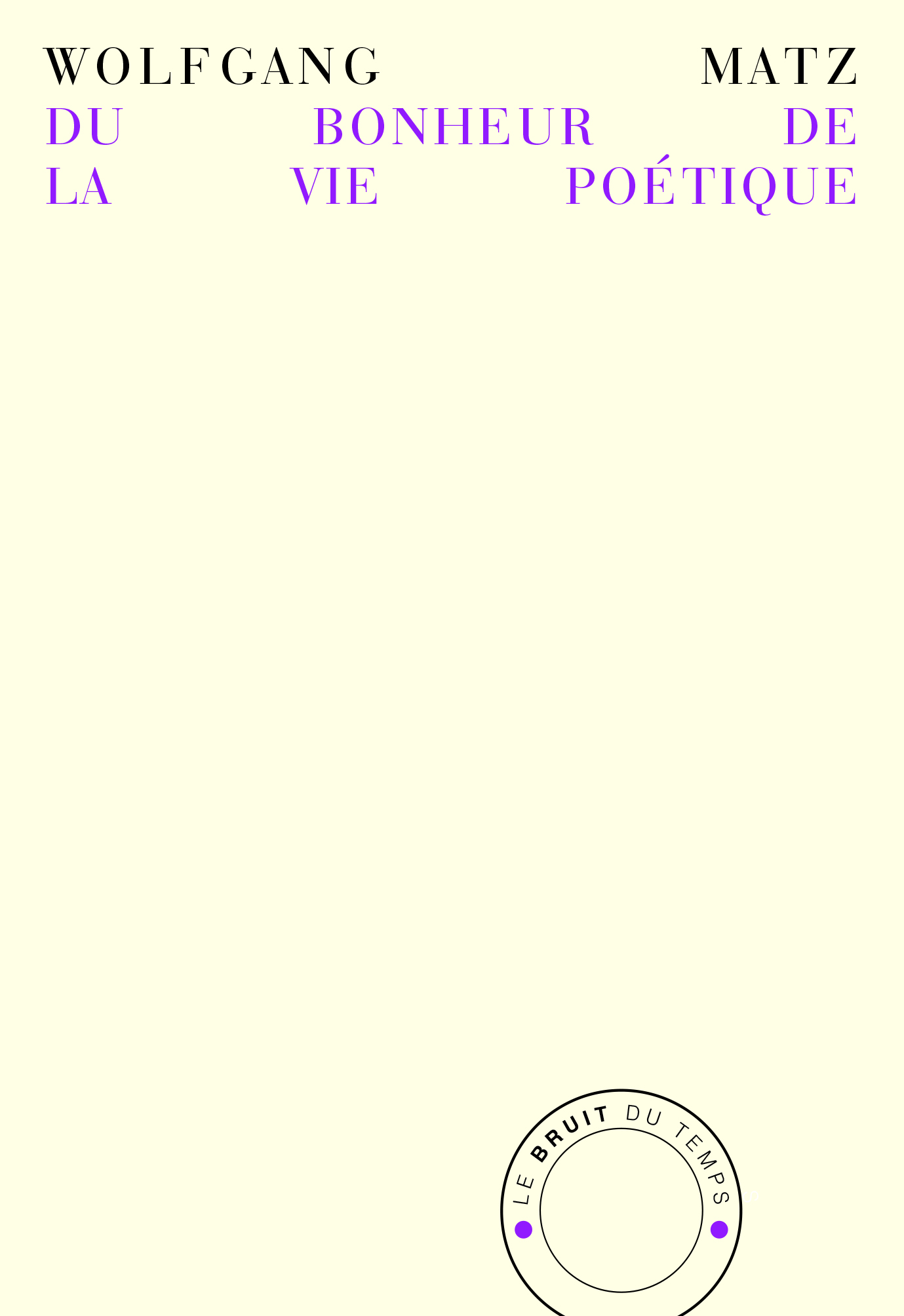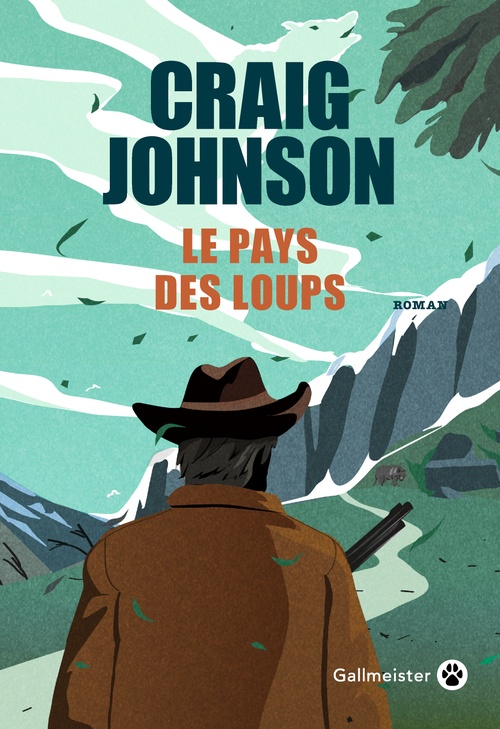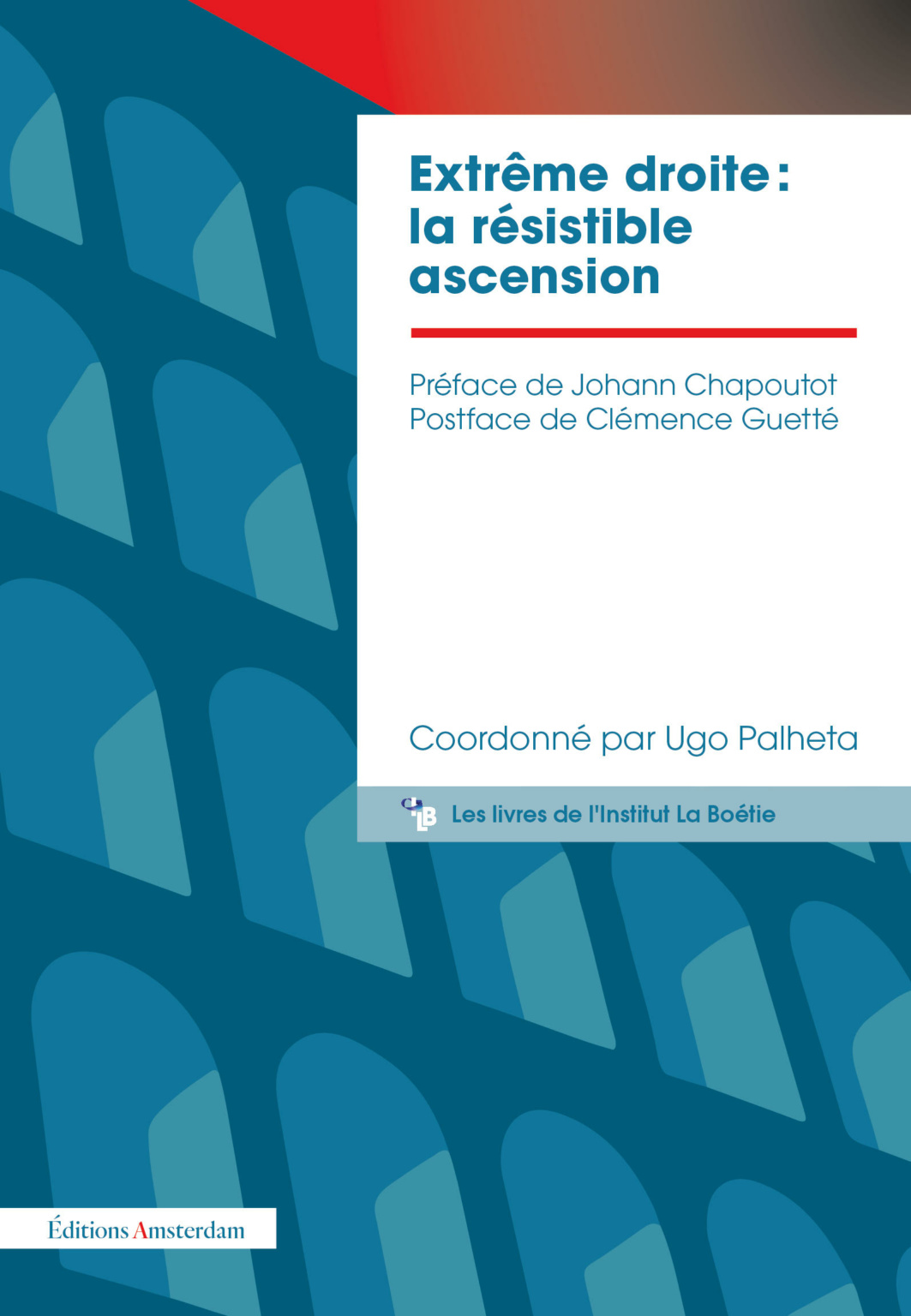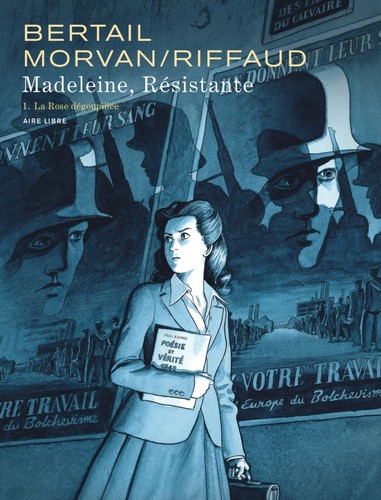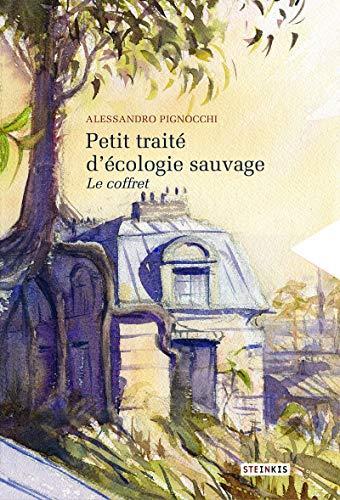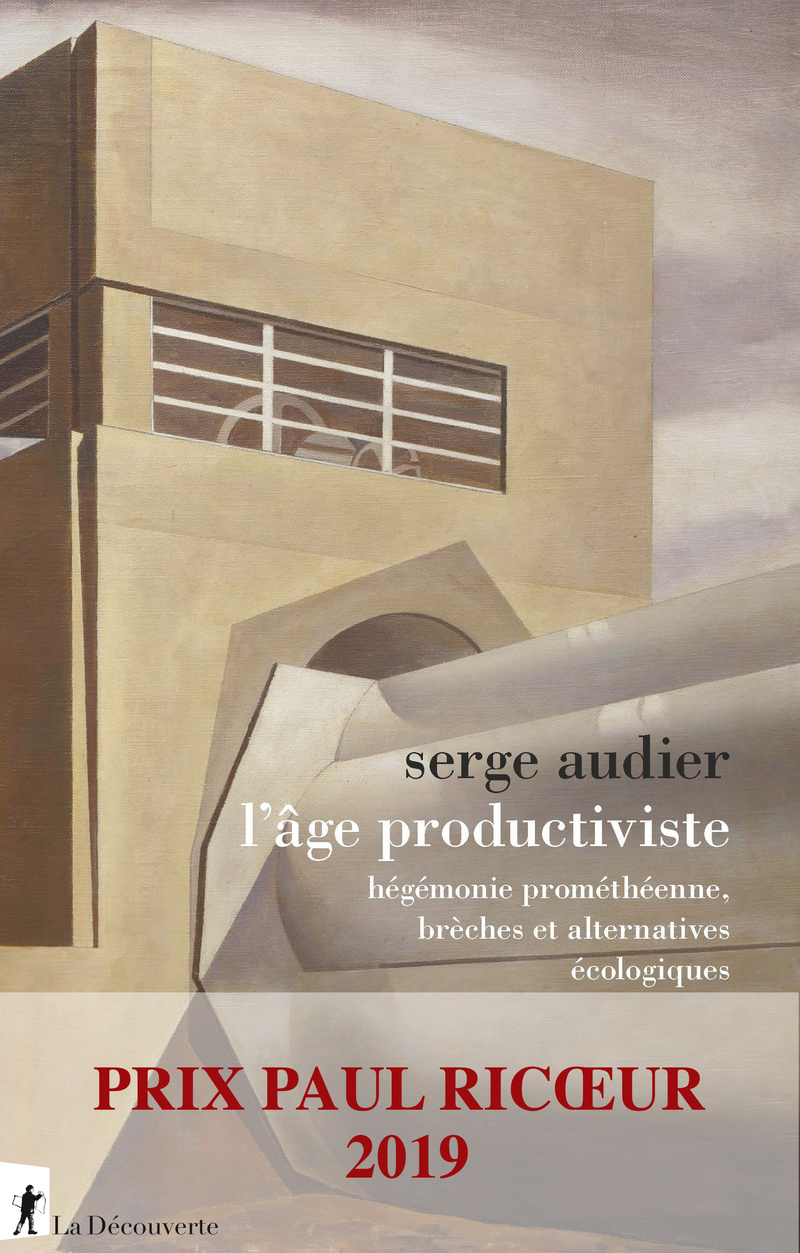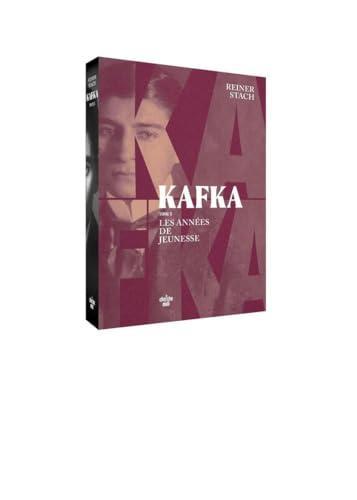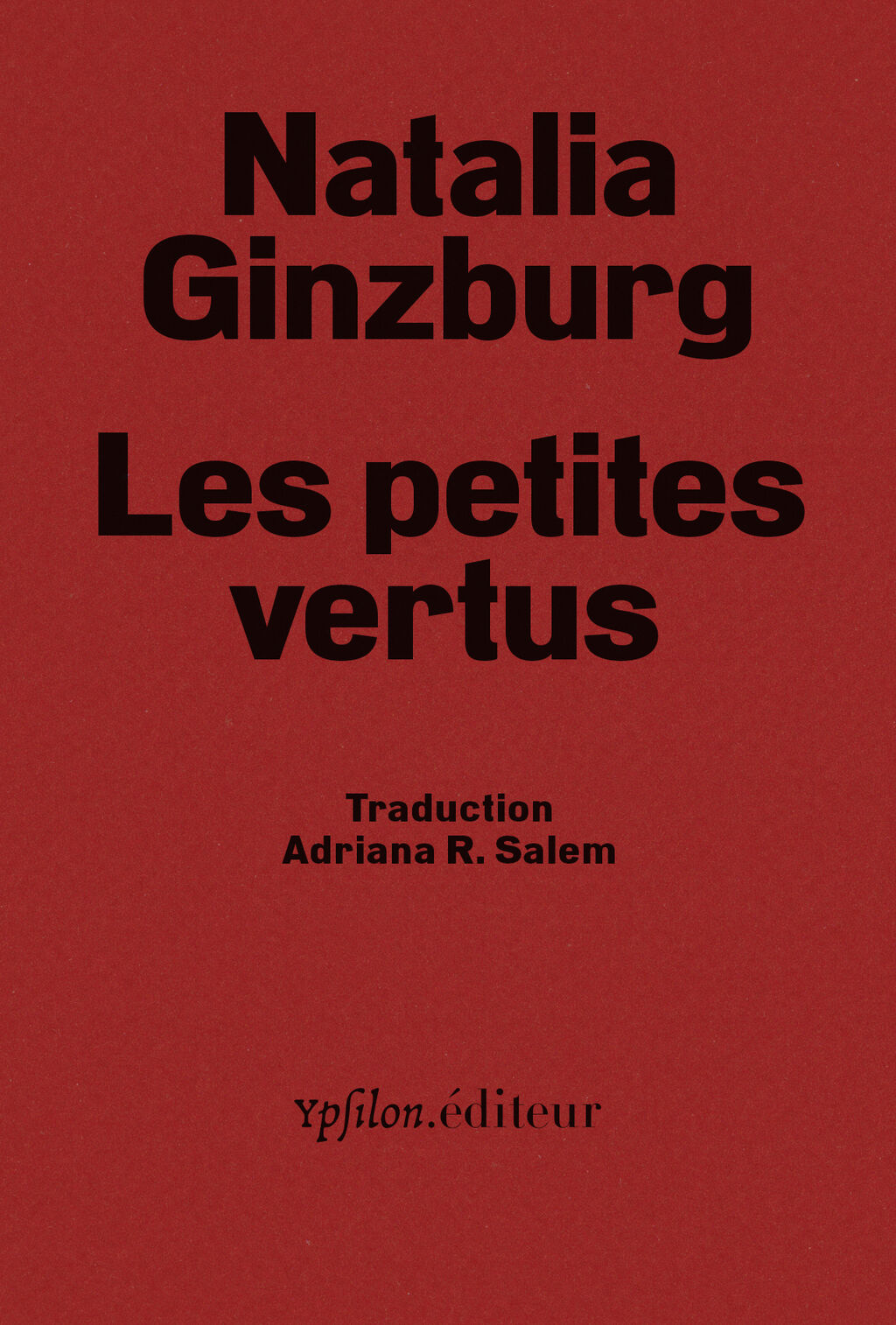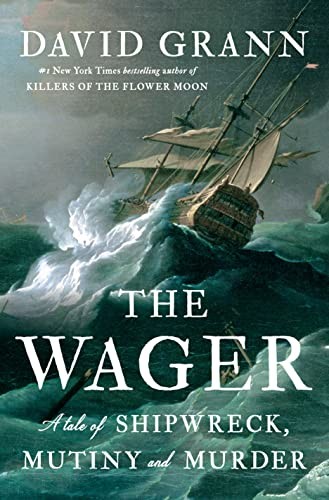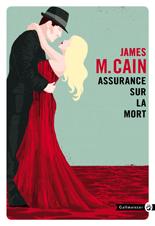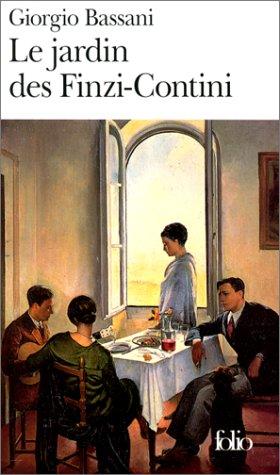Antoine Chambert-Loir a commencé la lecture de Du bonheur de la vie poétique par Wolfgang Matz
Un « petit » livre nous dit la 4e de couverture, mais rempli d'une telle profondeur, d'une telle luminosité, d'une tell' intelligence et surtout d'un tel amour pour son sujet, la poésie et ces trois comparses-poètes qu'étaient André du Bouchet, Yves Bonnefoy et Philippe Jaccottet, qu'il n'était pas utile qu'il fût plus épais. Sublime.